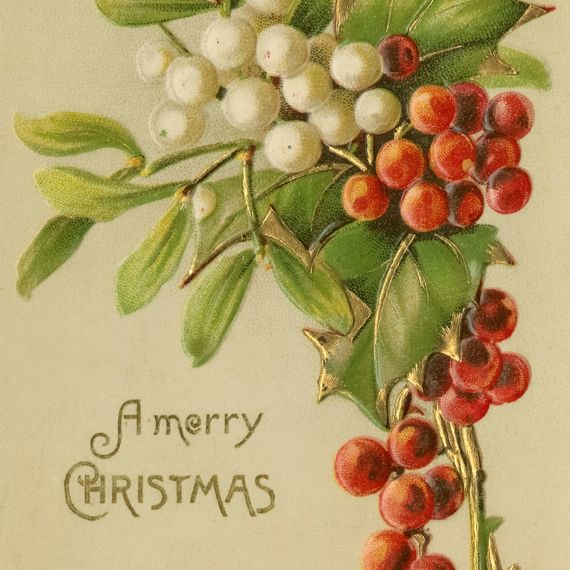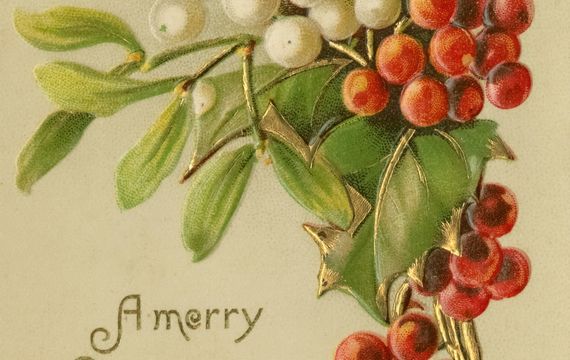Lumière en temps de guerre
Britten composa A Ceremony of Carols en 1942, au cours d’une traversée maritime de plusieurs mois reliant les États-Unis à son pays natal. Les conditions étaient loin d’être idéales : « Nous logions dans une cabine que Peter Pears décrivait comme misérable, chaude et poussiéreuse, avec une odeur insupportable. L’équipage s’avérait inexpérimenté et bruyant ; ils se comportaient comme des insensés. À cela s’ajoutait la menace constante d’une attaque de sous-marins. Rien de très inspirant, et pourtant. Que peut faire un compositeur, enfermé sur un navire avec quelques vieux textes et une petite harpe, sinon écrire de la musique ? »
Lors de cette traversée oppressante, Britten trouva refuge dans l’anthologie poétique The English Galaxy of Short Poems, achetée lors d’une escale dans le port canadien d’Halifax. Plusieurs textes en vieil anglais évoquant la période de Noël l’inspirèrent à composer quelques carols. Mais à son arrivée en Angleterre, la douane confisqua la partition — on soupçonnait Britten d’y avoir dissimulé des messages codés. Heureusement, il put les convaincre du contraire et récupéra son œuvre.
Britten décrivait lui-même la composition comme un mélange de textes médiévaux anonymes et de poèmes plus tardifs mis en musique. Une œuvre presque de Noël pour voix de garçons. Après la création réussie du 5 décembre 1942 à la bibliothèque du Norwich Castle, Britten enrichit le recueil de quelques chants supplémentaires et d’un interlude pour harpe. Et afin d’en façonner un ensemble cohérent, il ajouta l’antienne grégorienne Hodie Christus natus est en ouverture et en conclusion. Entre ces deux pôles sacrés, les chants passent d’une prière intérieure à une danse exubérante. A Ceremony of Carols devient ainsi bien plus qu’une musique de la Nativité : une célébration intime de la lumière et de l’espérance, écrite sur fond de guerre menaçante.
Sons divins et festifs
Le choix de Britten d’ajouter une harpe au chœur de garçons dans A Ceremony of Carols n’était pas seulement pragmatique ou lié à la couleur sonore : il s’inscrivait aussi dans la tradition séculaire associant la harpe aux harmonies célestes et au monde spirituel. Dans l’iconographie médiévale, l’instrument apparaît souvent entre les mains d’anges, symbole de la musique divine. Dans les contextes religieux, la harpe accompagnait également les moments de recueillement et de contemplation, en contrepoint à la sonorité monumentale du chœur et de l’orgue. Ces résonances se retrouvent dans la partition de Britten, où la harpe accentue le caractère intime et serein de l’œuvre.
Le harpiste, compositeur et pédagogue français Carlos Salzedo (1885–1961) prolongea cette tradition dans ses Paraphrases pour harpe seule. Il y enrichit les mélodies simples et populaires des chants de Noël d’ornements virtuoses, d’harmonies complexes et de passages improvisés. Et que la harpe puisse également déployer toute sa splendeur, les premières mesures de la célèbre Valse des fleurs du ballet Casse-Noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840–1893) en apportent une preuve éclatante.
Les œuvres de Noël a cappella de compositeurs tels qu’Herbert Howells (1892–1983), Gustav Holst (1874–1934) ou John Rutter (1945) prolongent chaleureusement ce programme. Elles célèbrent la venue joyeuse de Jésus, porteur de lumière, ou rendent hommage à la Vierge Marie. « In the Bleak Midwinter » décrit le cadre modeste mais empreint d’amour de la naissance du Christ. Holst en saisit l’atmosphère dans un hymne recueilli, qu’Ola Gjeilo (1978), compositeur norvégien, arrangea ensuite dans son style cinématographique et luxuriant. Dans la subtile mise en musique par Howells de « A Spotless Rose » — traduction anglaise du poème anonyme du XIVe siècle Es ist ein Ros entsprungen — une rose naissante devient le symbole de la naissance du Christ au cœur d’une nuit d’hiver froide et sombre. Quant à la Hymn to the Virgin de Britten, elle constitue elle aussi un hommage à Marie. À travers les siècles, toutes ces œuvres portent la même message intemporel : offrir une lueur de lumière dans l’obscurité.
Aurélie Walschaert